Lauréats du premier appel à projet de l’Institut de la Leucémie

Lancement d'un appel à projet
L’IHU vise à atteindre les objectifs stratégiques suivants :
- Soutenir en amont les projets ambitieux qui ne sont pas encore assez mûrs pour obtenir un financement ;
- Encourager les collaborations entre les chercheurs et les cliniciens de l’IHU, ainsi qu’avec les acteurs industriels en s’appuyant sur l’expertise d’Opale.
Pour garantir un soutien rapide, les candidatures dans la catégorie LEVEE DE VERROU sont acceptées tout au long de l’année pour un montant maximum de 30K euros.
Pour les catégories SYNERGIE et PHASES CLINIQUES PRECOCES, des appels à projets ont lieu deux fois par an (mars et septembre).
Les candidatures sont ouvertes à tous les chefs d’équipe, et chercheurs avec l’accord de leur chef.
Nabih Maslah
Equipe Giraudier, en collaboration avec Hugues de Thé

Les néoplasmes myéloprolifératifs (MPN) BCR-ABL1 négatifs représentent un groupe hétérogène d’hémopathies malignes caractérisées par une prolifération accrue des lignées myéloïdes hématopoïétiques, conduisant à un excès de cellules sanguines matures. Ils incluent la polyglobulie de Vaquez (PV), la thrombocytémie essentielle (TE) et la myélofibrose primitive (PMF).
Les lésions moléculaires initiatrices de la maladie sont bien identifiées : mutations JAK2V617F, MPLW515 ou CALR de l’exon 9.
Notre groupe et d’autres ont montré que l’interféron alpha (IFNα) est le seul traitement capable d’induire des rémissions moléculaires, grâce à un ciblage préférentiel des cellules mutées JAK2V617F ou CALR. Nous avons récemment démontré que ce traitement induit une sénescence dépendante de PML lorsqu’il est associé à l’arsenic trioxide (ATO).
Cependant, les patients traités par IFNα conservent une charge tumorale détectable, suggérant l’existence d’une résistance au traitement au sein d’une population cellulaire à phénotype sénescent.
Dans le but d’éliminer ces cellules souches leucémiques résiduelles résistantes, ce projet vise à tester une nouvelle combinaison thérapeutique basée sur un traitementpro-sénescent (IFNα ± ATO) associé à un traitement sénolytique. Des approches in vivo et in vitro seront développées pour évaluer cette stratégie innovante.
Matthieu Duchmann
Equipe Itzykson

Les leucémies aiguës myéloïdes (LAM) avec mutation NPM1 représentent 30 % des LAM chez l’adulte, elle présente fréquemment des mutations ciblables dans FLT3 ou IDH1 et exprime souvent le CD33 qui peut-être ciblé par des anticorps monoclonaux. La plupart des patients obtiennent une rémission complète avec le traitement de première ligne, mais la moitié d’entre eux rechutent.
Le suivi de la maladie résiduelle (MRD) NPM1 permet de quantifier les rares cellules leucémiques résiduelles lors du suivi des patients en réponse. Des études rétrospectives suggèrent que les traitements préemptifs de la rechute moléculaire avant la rechute cytologique conduisent à de meilleurs résultats à long terme. Cependant, il n’existe aucune recommandation pour les traitements de deuxième ligne en raison de l’évolution clonale fréquente et imprévisible lors de la rechute, et d’un obstacle technologique empêchant la caractérisation des rares cellules leucémiques résiduelles. L’évaluation génétique et phénotypique des cellules leucémiques unicellulaires lors de la rechute moléculaire est donc nécessaire pour optimiser les décisions thérapeutiques.
Nous souhaitons améliorer un protocole de multi-omique en cellules uniques afin de capturer tous les biomarqueurs de résistance et de réponse aux traitements de deuxième ligne dans les LAM NPM1 en rechute moléculaire. En plus de l’identification des mutations somatiques et la détection des protéines de surface, nous voulons quantifier les protéines intracellulaires impliquées dans la résistance à l’apoptose, les dépendances métaboliques et les voies de signalisation intracellulaires.
Grâce à ce financement initial, nous espérons démontrer la faisabilité de cette approche, afin de solliciter un financement national pour évaluer sa pertinence dans le cadre d’un essai clinique prospectif national avec les groupes coopérateurs ALFA et FILO.
Valéria Bisio
Equipe Balabanian, en collaboration avec Raphaël Itzykson
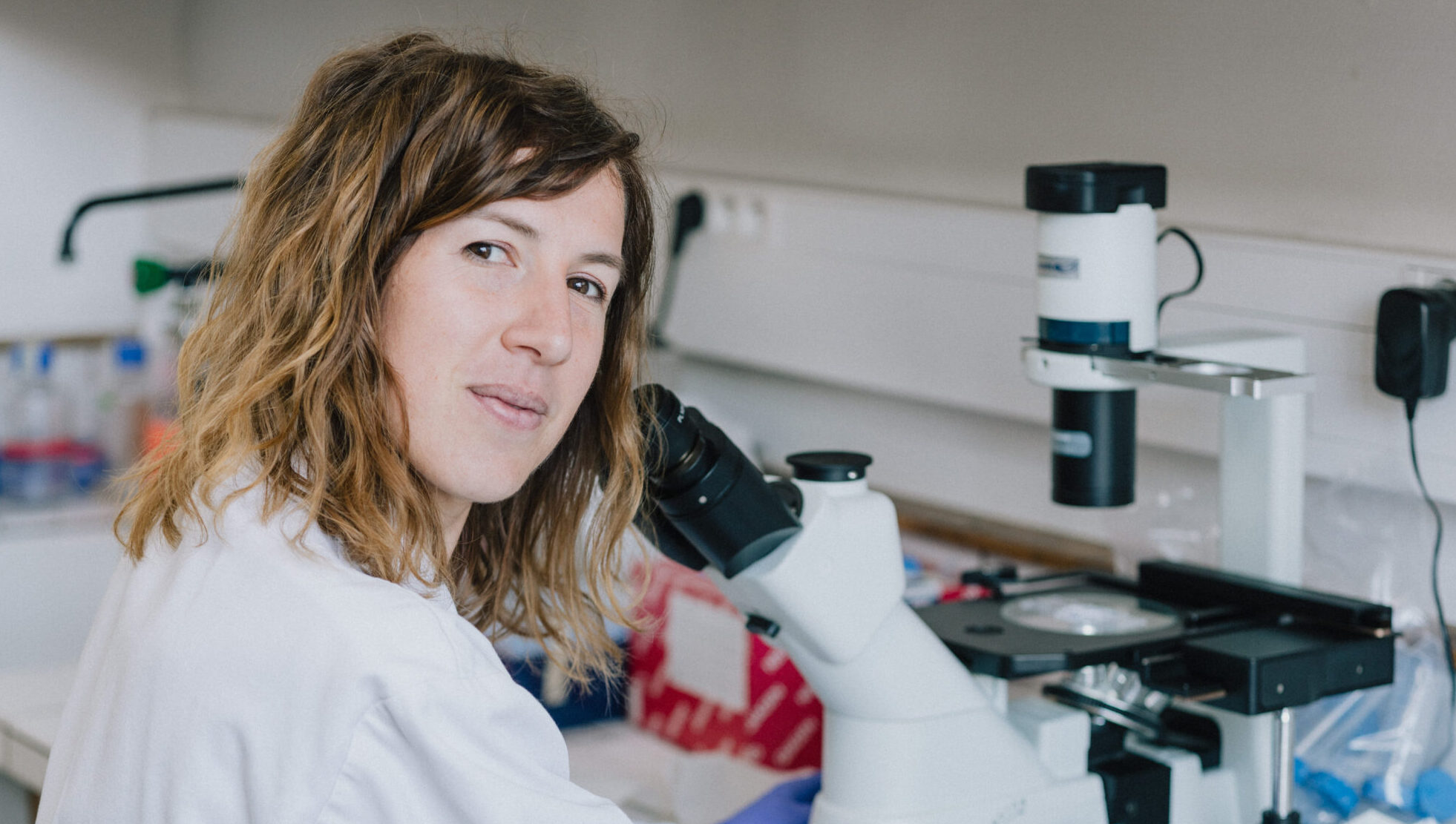
Les mutations récurrentes de IDH1/2 sont fréquentes dans environ 20 % des leucémies myéloïdes aiguës (LMA) et 10 % des syndromes myélodysplasiques (SMD). Elles entraînent la production de l’onco-métabolite R-2-hydroxyglutarate (R-2HG), lequel inhibe les enzymes dépendantes du 2-oxoglutarate, provoquant d’importantes altérations métaboliques et épigénétiques au sein des cellules leucémiques.
Diffusible, le R-2HG pourrait également perturber le microenvironnement tumoral médullaire (TME) en altérant la fonction des cellules stromales et immunitaires.
Alors que les effets intrinsèques des mutations IDH ont été largement étudiés, leurs effets extrinsèques sur les cellules du stroma et du système immunitaire restent mal compris. Ce projet utilise des organoïdes médullaires artificiels (AMO) pour explorer les effets paracrines du R-2HG dans la création d’un microenvironnement immunosuppresseur, en se concentrant sur l’impact de cette molécule sur la fonction immunitaire et stromale ainsi que sur la progression leucémique.
L’un des objectifs majeurs est d’identifier des thérapies synergétiques ciblant les mutations IDH2 afin de restaurer la fonction immunitaire et d’inhiber la croissance leucémique. Le projet combine l’expertise en caractérisation immuno-stromale et culture d’organoïdes (Équipe Balabanian) avec des approches de RNA-seq à cellule unique et de criblage pharmacologique ex vivo (Équipe Itzykson) pour valider l’activité pré-clinique.
Le développement de modèles ex vivo évolutifs, intégrant un environnement leucémique humain immuno-compétent, contribuera à la mise au point de thérapies personnalisées tout en réduisant l’utilisation de modèles animaux.
L’objectif final est d’optimiser les traitements ciblant le système immunitaire, et d’apporter de nouvelles perspectives thérapeutiques combinées pour améliorer le pronostic des patients atteints de leucémies mutées IDH2.
Aurore Touzart
Equipe Asnafi, en collaboration avec Antoine Toubert (équipe Balabanian)

La LAL-T ETP (Early T-cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia) est un sous-type agressif de leucémie aiguë lymphoblastique T, caractérisé par une mauvaise réponse précoce à la chimiothérapie et un taux élevé d’échec d’induction, soulignant la nécessité de développer de meilleurs modèles expérimentaux et de nouvelles stratégies thérapeutiques.
Ce sous-type de leucémie est par ailleurs caractérisé par de fréquentes altérations de régulateurs épigénétiques.
Ce projet vise à développer le premier modèle humain de (pré-)leucémie LAL-T ETP à l’aide d’un système tridimensionnel d’organoïdes thymiques artificiels (3D-ATO), combiné à une modélisation in vivo chez la souris NSG.
Nous étudierons les conséquences des altérations épigénétiques sur le développement thymique ainsi que la coopération oncogénique entre les altérations génomiques et épigénétiques, en modélisant deux sous-types (épi)génétiques majeurs : DNMT3A R882H ± NOTCH1ΔE, et EZH2 perte de fonction (LOF) ± PICALM::MLLT10.
Des analyses multi-omiques (RNA-seq, méthylation de l’ADN et modifications post-traductionnelles d’histones) seront réalisées à différents stades de différenciation dans le système ATO et chez la souris.
Ces jeux de données seront intégrés et comparés aux profils de progéniteurs thymiques normaux et à des échantillons primaires de patients atteints de LAL-T ETP, afin d’identifier les déviations du programme de différenciation normal et les altérations cliniquement pertinentes.
Cette approche synergique vise à mettre en évidence des vulnérabilités épigénétiques, notamment celles impliquant l’interaction DNMT3A–PRC1 et les mécanismes compensatoires liés à la perte de fonction de PRC2, dans le but d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et de favoriser le développement de traitements innovants à base d’épi-médicaments pour les patients atteints de LAL-T ETP.