- L’institut
- Un nouvel Institut Hospitalo-Universitaire
- Programme médico-scientifique
- Histoire de l’hématologie sur le campus de Saint-Louis
- Gouvernance de l’Institut
- Espace presse
- Nous contacter
- Notre actualité
- Portrait de Valéria Bisio, chargée de recherche
- Création d’une unité d’hémato-oncogénétique
- Portrait d’Alice Gros, patiente pair-aidante
- Lauréats du premier appel à projet de l’Institut de la Leucémie
- Portrait de Julien Calvo, chercheur
- Nous soutenir
- Nous rejoindre
- Vous êtes
- Patients et proches
- Être soigné et accompagné
- Nos services cliniques
- Nos soins de support
- Traitements anti-cancéreux
- Notre recherche clinique sur les leucémies
- Devenir patient expert
- Découvrir l’Institut
- Chercheurs
- Recherche
- Essais cliniques
- Découvrir l’Institut
- Professionnels de la santé
- Adresser un patient
- Notre recherche clinique
- Découvrir l’Institut
- Un nouvel Institut pour la lutte contre la leucémie
- Histoire de l’hématologie sur le campus de Saint-Louis
- Industriels
- Découvrir l’Institut
- Recherche translationnelle
- Donateurs
- Nous soutenir
- Découvrir l’Institut
- Soin
- Prise en charge des patients
- Etre soigné à l’Institut de la Leucémie
- Traitements anti-cancéreux
- Soins de support
- Réunions de concertation pluridisciplinaires ouvertes
- Nos services cliniques
- Hôpital Saint-Louis – Service Hématologie Adultes
- Hôpital Saint-Louis – Service Hématologie Greffe
- Hôpital Saint-Louis – Service de Pharmacologie et Investigations Cliniques
- Hôpital Saint-Louis – Service Adolescents Jeunes Adultes
- Hôpital Saint-Louis – Unité ambulatoire d’hémato-oncogénétique
- Hôpital Saint-Louis – Service Hématologie Séniors
- Hôpital Robert-Debré – Service d’Hématologie et immunologie pédiatrique
- Hôpital Necker – Service d’Hématologie Adulte
- Hôpital Cochin-Port Royal – Service Hématologie Clinique
- Hôpital Avicenne – Service Hématologie Clinique et Thérapie Cellulaire
- Nos laboratoires de biologie médicale
- Laboratoire d’hématologie biologique, Michaela Fontenay
- Laboratoire d’hématologie biologique, Jean Soulier
- Unité fonctionnelle de génétique moléculaire, Hélène Cavé
- Laboratoire d’hématologie biologique, Vahid Asnafi
- Informations pour les patients
- Leucémies Aiguës Myéloïdes
- Leucémies Aiguës Lymphoïdes
- Néoplasies Myéloprolifératives
- Syndromes Myélodysplasiques
- Traitements anti-cancéreux
- Soins de support
- Accompagnement des patients atteints de leucémies
- Recherche
- Nos équipes de recherche
- Equipe de Hugues de Thé – Pathologie Moléculaire
- Equipe de Raphael Itzykson – Médecine de précision fonctionnelle des leucémies
- Equipe de Michaela Fontenay – Hématopoiese normale et pathologique
- Equipe de Françoise Pflumio – Niche, cancer et radiation dans l’hématopoïèse
- Equipe de Sylvie Méléard – Evolution de populations et système d’interactions de particules
- Equipe de David Michonneau – Immunologie translationelle en immunothérapie et hématologie
- Equipe de Lina Benajiba – Identification et ciblage des régulateurs extrinsèques des hémopathies myéloïdes
- Equipe de Karl Balabanian – Niches lymphoïdes, chimiokines et syndromes immuno-hématologiques
- Equipe d’Alexandre Puissant – Bases moléculaires du développement des leucémies aiguës myéloïdes
- Equipe de Stéphane Giraudier – Hémopathies myéloïdes chroniques, microenvironnement & recherche translationnelle
- Equipe de Diana Passaro – Leucémie et dynamiques de la niche
- Equipe de Camille Lobry – Contrôle génétique et épigénétique de l’hématopoïèse normale et maligne
- Equipe de Jean Soulier – Aplasie et leucémies secondaires
- Equipe de Sylvie Chevret – Biostatistiques et épidémiologie clinique
- Nos plateformes technologiques
- Notre recherche clinique sur les leucémies
- Participer à un essai clinique
- Portail de transparence
- eTHEMA : La cohorte des patients atteints de leucémies
- Enseignement
Accueil Prise en charge des patients atteints de leucémies et de maladies apparentées Notre recherche clinique sur les leucémiesNotre recherche clinique sur les leucémies
...Notre recherche clinique sur les leucémies
Cette page a pour objectif de détailler la recherche clinique sur les leucémies menée au sein de l’Institut de la Leucémie, de décrire les modalités d’utilisation des données de santé et des échantillons biologiques, et de rappeler aux participants leurs droits concernant l’utilisation de leurs données personnelles de santé à des fins de recherche.
Nous listons également la recherche clinique auxquelles l’institut contribue en collaboration avec l’AP-HP Hôpital Saint-Louis, Hôpital Robert Debré, Hôpital Necker, Hôpital Cochin, l’Inserm, et les autres partenaires.
Registre eTHEMA
Le registre eTHEMA, soutenu par l’Agence Nationale pour la Recherche dans le cadre du Plan gouvernemental d’Investissements d’Avenir, réunit des données de la recherche sur les leucémies et maladies apparentées dans l’objectif continu d’améliorer la compréhension et la prise en charge de ces maladies par des médecins, des biologistes et des techniciens de recherche de trois hôpitaux de l’AP-HP (Saint-Louis, Robert Debré, Avicenne).
Les données enregistrées dans le CRF eTHEMA sont le reflet des données sources collectées prospectivement dans le dossier hospitalier ou des résultats d’examens biologiques. En parallèle, les données des échantillons biologiques de routine (sang, moelle osseuse) ou de recherche collectés et congelés au Centre de Ressources Biologique (CRB) SLS/THEMA certifié, seront localisées dans le bâtiment de recherche translationnel MEARY à proximité du data center eTHEMA, sous la responsabilité du Pr Emmanuelle Clappier (Laboratoire du service d’Hématologie biologique, hôpital Saint louis, Paris).
Nos collections biologiques
L’Institut de la Leucémie participe à l’Observatoire Biobanque pour la Recherche Translationnelle en hématologie (BiRTH), et à l’observatoire RIME (Observatoire national des insuffisancesmédullaires) qui visent à recueillir de façon prospective et rétrospective des informations standardisées (données cliniques et biologiques) et anonymes pour chaque patient
Réutilisation des échantillons biologiques et des données associées, à des fins de recherche scientifique
Les échantillons biologiques prélevés dans le cadre des soins ou de la recherche clinique sur les leucémies peuvent être conservés dans une collection biologique, accompagnés de certaines données de santé, à des fins d’études, d’évaluation et de recherche scientifique.
Lors d’une consultation ou d’une hospitalisation, des prélèvements biologiques peuvent être réalisés afin d’effectuer des analyses biologiques, génétiques ou autres, dans un but de diagnostic, de suivi ou de traitement. Ces échantillons peuvent inclure divers types de prélèvements (sang, urine, salive, peau, selles, tissus…).
Si une partie des échantillons collectés n’a pas été utilisée pour les analyses initialement prévues, les patients et, si nécessaire, leurs parents peuvent être sollicités pour donner leur accord quant à la conservation des échantillons restants dans une collection biologique. Cette conservation permet de mener des recherches dans le cadre de programmes scientifiques ou cliniques portant sur les maladies génétiques et, plus largement, sur les maladies rares. Des données cliniques associées (comme des informations socio-démographiques, le diagnostic, les symptômes, les traitements administrés et les résultats d’analyses) seront également stockées avec ces échantillons dans le but de mener ces recherches.Dans ce cadre, les patients auront signé un consentement ou reçu un document d’information précisant :
- La nature des échantillons conservés, les objectifs des recherches scientifiques, les modalités de conservation et les données de soin associées
- Le cadre réglementaire applicable au traitement des données personnelles, notamment le processus de codage des échantillons et des données pour garantir l’anonymat des personnes concernées
- Les droits des patients concernant l’accès, la rectification, l’opposition, l’effacement, la limitation et la portabilité de leurs données, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi « Informatique et libertés », ainsi que les coordonnées des interlocuteurs à contacter pour exercer ces droits.
Suivez nos actions en vous inscrivant à la lettre d'information de l’institut
- Découvrir l’Institut
- Recherche translationnelle
- Notre recherche clinique
- Essais cliniques
- Être soigné et accompagné
- Un nouvel Institut Hospitalo-Universitaire
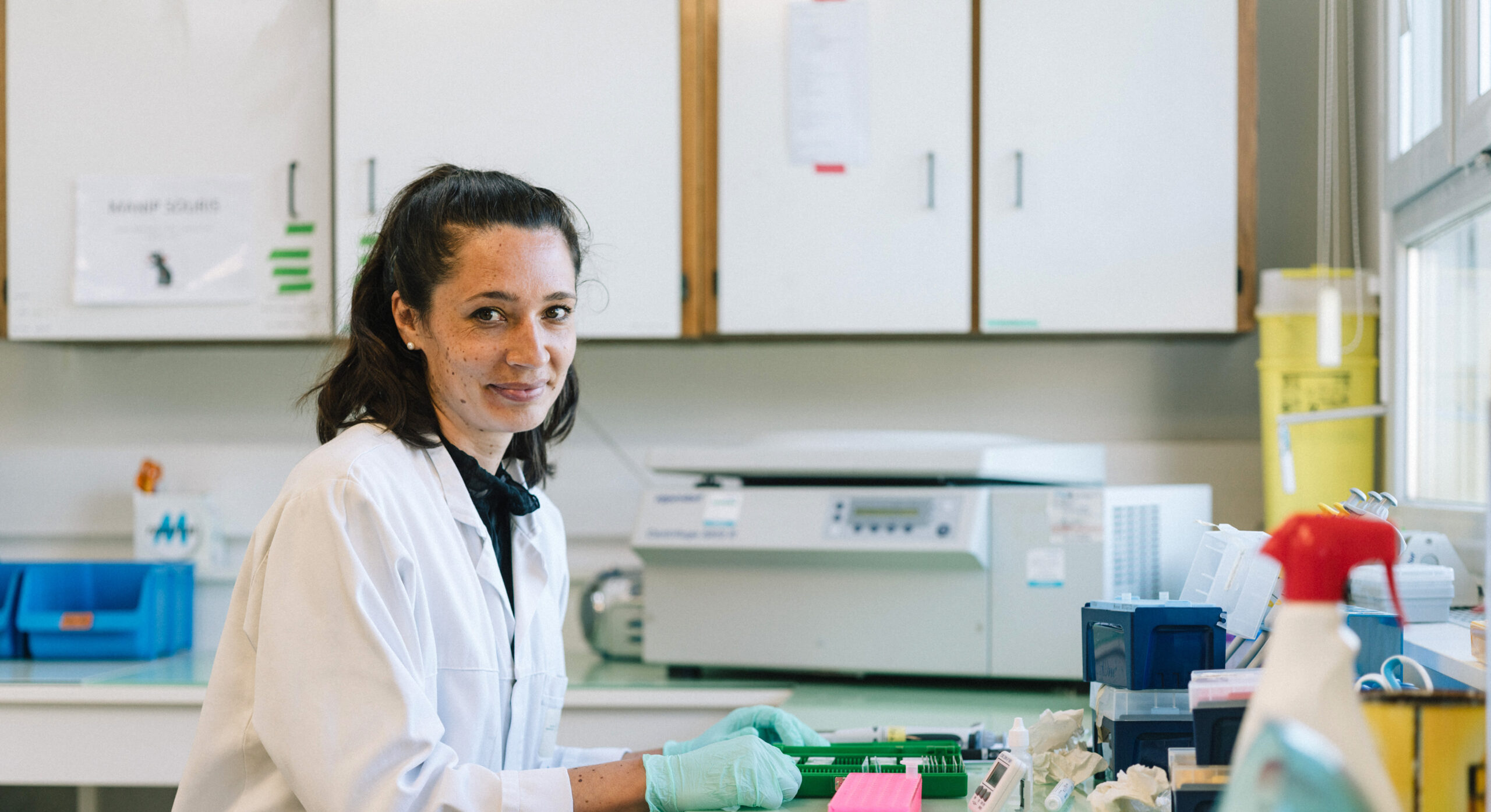

Portail de transparence, réutilisation des données de santé et droits des personnes
Dans le cadre d’une recherche clinique sur les leucémies conduite par l’Institut de la Leucémie ou à laquelle celui-ci apporte son soutien, chaque patient impliqué a signé un consentement ou reçu une lettre d’information. Ce document précise que les données de santé recueillies au cours de l’étude peuvent être réutilisées pour d’autres travaux scientifiques, visant à améliorer les connaissances médicales et thérapeutiques sur la maladie étudiée.
Pour chaque étude clinique, les informations des participants sont regroupées dans une base de données après avoir été pseudonymisées. Ces données ne permettent pas d’identifier directement les individus, car elles n’incluent ni nom, ni prénom, ni informations de contact. Seule l’équipe de recherche détient la liste permettant d’établir le lien entre le code attribué et l’identité de la personne.