- L’institut
- Un nouvel Institut Hospitalo-Universitaire
- Programme médico-scientifique
- Histoire de l’hématologie sur le campus de Saint-Louis
- Gouvernance de l’Institut
- Espace presse
- Nous contacter
- Notre actualité
- Portrait de Valéria Bisio, chargée de recherche
- Création d’une unité d’hémato-oncogénétique
- Portrait d’Alice Gros, patiente pair-aidante
- Lauréats du premier appel à projet de l’Institut de la Leucémie
- Portrait de Julien Calvo, chercheur
- Nous soutenir
- Nous rejoindre
- Vous êtes
- Patients et proches
- Être soigné et accompagné
- Nos services cliniques
- Nos soins de support
- Traitements anti-cancéreux
- Notre recherche clinique sur les leucémies
- Devenir patient expert
- Découvrir l’Institut
- Chercheurs
- Recherche
- Essais cliniques
- Découvrir l’Institut
- Professionnels de la santé
- Adresser un patient
- Notre recherche clinique
- Découvrir l’Institut
- Un nouvel Institut pour la lutte contre la leucémie
- Histoire de l’hématologie sur le campus de Saint-Louis
- Industriels
- Découvrir l’Institut
- Recherche translationnelle
- Donateurs
- Nous soutenir
- Découvrir l’Institut
- Soin
- Prise en charge des patients
- Etre soigné à l’Institut de la Leucémie
- Traitements anti-cancéreux
- Soins de support
- Réunions de concertation pluridisciplinaires ouvertes
- Nos services cliniques
- Hôpital Saint-Louis – Service Hématologie Adultes
- Hôpital Saint-Louis – Service Hématologie Greffe
- Hôpital Saint-Louis – Service de Pharmacologie et Investigations Cliniques
- Hôpital Saint-Louis – Service Adolescents Jeunes Adultes
- Hôpital Saint-Louis – Unité ambulatoire d’hémato-oncogénétique
- Hôpital Saint-Louis – Service Hématologie Séniors
- Hôpital Robert-Debré – Service d’Hématologie et immunologie pédiatrique
- Hôpital Necker – Service d’Hématologie Adulte
- Hôpital Cochin-Port Royal – Service Hématologie Clinique
- Hôpital Avicenne – Service Hématologie Clinique et Thérapie Cellulaire
- Nos laboratoires de biologie médicale
- Laboratoire d’hématologie biologique, Michaela Fontenay
- Laboratoire d’hématologie biologique, Jean Soulier
- Unité fonctionnelle de génétique moléculaire, Hélène Cavé
- Laboratoire d’hématologie biologique, Vahid Asnafi
- Informations pour les patients
- Leucémies Aiguës Myéloïdes
- Leucémies Aiguës Lymphoïdes
- Néoplasies Myéloprolifératives
- Syndromes Myélodysplasiques
- Traitements anti-cancéreux
- Soins de support
- Accompagnement des patients atteints de leucémies
- Recherche
- Nos équipes de recherche
- Equipe de Hugues de Thé – Pathologie Moléculaire
- Equipe de Raphael Itzykson – Médecine de précision fonctionnelle des leucémies
- Equipe de Michaela Fontenay – Hématopoiese normale et pathologique
- Equipe de Françoise Pflumio – Niche, cancer et radiation dans l’hématopoïèse
- Equipe de Sylvie Méléard – Evolution de populations et système d’interactions de particules
- Equipe de David Michonneau – Immunologie translationelle en immunothérapie et hématologie
- Equipe de Lina Benajiba – Identification et ciblage des régulateurs extrinsèques des hémopathies myéloïdes
- Equipe de Karl Balabanian – Niches lymphoïdes, chimiokines et syndromes immuno-hématologiques
- Equipe d’Alexandre Puissant – Bases moléculaires du développement des leucémies aiguës myéloïdes
- Equipe de Stéphane Giraudier – Hémopathies myéloïdes chroniques, microenvironnement & recherche translationnelle
- Equipe de Diana Passaro – Leucémie et dynamiques de la niche
- Equipe de Camille Lobry – Contrôle génétique et épigénétique de l’hématopoïèse normale et maligne
- Equipe de Jean Soulier – Aplasie et leucémies secondaires
- Equipe de Sylvie Chevret – Biostatistiques et épidémiologie clinique
- Nos plateformes technologiques
- Notre recherche clinique sur les leucémies
- Participer à un essai clinique
- Portail de transparence
- eTHEMA : La cohorte des patients atteints de leucémies
- Enseignement
Accueil Prise en charge des patients atteints de leucémies et de maladies apparentées Néoplasies myéloproliférativesNéoplasies myéloprolifératives
...Les différentes néoplasies myéloprolifératives
Thrombocytémie essentielle
Polyglobulie de Vaquez
Myélofibrose primitive
Thrombocytémie essentielle
Polyglobulie de Vaquez
Myélofibrose primitive
Comprendre les néoplasies myéloprolifératives
Les néoplasies myéloprolifératives (NMP) sont des maladies du sang dues à une anomalie génétique impactant la production des cellules sanguines. Bien que considérées comme des cancers du sang, leur gravité est souvent moindre.
Il existe trois sous-types principaux de NMP :
La thrombocytémie essentielle : Augmentation de la production de plaquettes. Environ 2000 nouveaux cas par an en France : c’est la NMP la plus fréquente.
La polyglobulie de Vaquez : Augmentation de la production de globules rouges. Environ 1000 nouveaux cas par an en France.
La myélofibrose primitive : L’augmentation peut porter sur les globules rouges, blancs ou les plaquettes ets’accompagne de fibrose médullaire (sorte de tissu cicatriciel qui remplace petit àpetit les cellules normales de la moelle osseuse). Environ 500 nouveaux cas par an en France.
Le diagnostic d’une NMP repose sur un ensemble d’examens qui permettent de définir au mieux votre maladie et de vous proposer le suivi/traitement le plus adapté.
Les résultats permettent de connaître le sous-type de votre NMP :
- Une prise de sang permet de réaliser une NFS (Numération Formule Sanguine), elle peut être accompagnée d’une mesure isotopique de la masse sanguine.
- Une échographie abdominale permet de connaître la taille de la rate.
- Une biopsie de la moelle osseuse
- La prise de sang permet aussi une analyse génétique.
Ces maladies peuvent être totalement asymptomatiques. Dans ce cas, elles peuvent être découvertes par hasard, grâce à une anomalie lors d’une prise de sang. Quand ils sont présents, les symptômes peuvent être très variés et pas nécessairement spécifiques : fatigue, maux de tête, manifestations visuelles (phosphènes), manifestations auditives (acouphènes), démangeaisons (en particulier pendant ou après une douche), sensations de brûlure et rougeur des mains ou pieds (érythromélalgies), pesanteur abdominale, augmentation de la taille de la rate (splénomégalie), douleurs de rate, perte de poids inexpliquée, sueurs profuses (en particulier la nuit), douleurs osseuses, douleurs d’une jambe révélatrice d’un caillot veineux (phlébite) …
Recherche clinique
Le rusfertide est un traitement qui module l’absorption et la disponibilité du fer dans les polyglobulies de Vaquez
Le bomedemstat est un traitement qui interfère avec la prolifération de la lignée des plaquettes, dans les thrombocytémies essentielles et les myélofibroses
Des anticorps dirigés contre la protéine CALR mutée sont en cours de tests.
Dans la myélofibrose, des combinaisons de traitements associent des molécules déjà utilisées dans les NMP (Ruxolitinib et Peginteféron alfa-2a) ou bien, des molécules avec des cibles thérapeutiques nouvelles (Inhibiteurs de MDM2, Inhibiteurs de Télomérase, Molécules bloquant le transport protéique dans la cellule) à des traitements validés dans les NMP afin d’étudier si l’ajout de ces nouvelles molécules permet de renforcer l’effet des traitements déjà existants.
Des études statistiques sur l’évolution de groupes de patients (cohortes) ont permis d’identifier de nouveaux facteurs de risque (cliniques et moléculaires) impliqués dans la survenue des thromboses ou dans l’évolution des NMP.
Des études à l’échelle nationale, en collaboration ont permis de mieux définir ces maladies et d’améliorer leur prise en charge.
La recherche clinique est le plus souvent de collaborations scientifiques, associant cliniciens, biologistes et dans le cas des NMP, le groupe coopérateur français des NMP (France Intergroupe des Syndromes Myéloprolifératifs ou FIM).
Recherche translationnelle
Les interactions entre les cellules hématopoïétiques et les cellules de la moelle osseuse afin d’essayer de prévenir et/ou traiter à la fois les NMP et leur évolution en maladie plus agressive
Lina Benajiba et son équipe
Le rôle de l’architecture clonale (c’est à dire des différents types de cellules mutées composants une tumeur ainsi que leur fréquence) et des mutations additionnelles, notamment les mutations du gène TP53, dans l’évolution des NMP
Stéphane Giraudier et son équipe
Association de patients
En savoir plusL’association « Vivre avec une NMP », créée en octobre 2021 et présidée par Mme Karin Tourmente-Leroux, est très active dans le domaine des NMP. Elle regroupe des malades et leurs familles mais aussi des médecins généralistes et spécialistes des NMP. Ses nombreuses actions ont pou objectifs de mieux faire connaître les NMP, faire avancer la recherche médicale et pharmaceutique et, informer et soutenir les patients atteints de NMP.
Suivez nos actions en vous inscrivant à la lettre d'information de l’institut
- Découvrir l’Institut
- Recherche translationnelle
- Notre recherche clinique
- Essais cliniques
- Être soigné et accompagné
- Un nouvel Institut Hospitalo-Universitaire



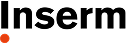

Traitement des néoplasies myéloprolifératives
En fonction du sous-type de NMP dont vous êtes atteint, le traitement qui vous sera proposé sera différent.
Pour l’ensemble des patients :
Si vous êtes à risque de thromboses (vous en avez déjà eu ou avez plus de 60 ans) :
Réduction du nombre élevé de globules dans votre sang grâce aux traitements dits cytoréducteurs. Deux sont principalement utilisés :
hebdomadaire.
Si vous êtes à faible risque (l’objectif du traitement est de traiter vos symptômes, il dépend de ces derniers) :
(ruxolitinib en 1ère ligne, ou fedratinib et momelotinib)
Si vous êtes à risque plus élevé (l’objectif du traitement est d’éviter l’évolution de votre maladie vers une maladie hématologique plus agressive) :
En fonction de vos comorbidités, de votre âge et de la présence de donneurs potentiels, une greffe de moelle osseuse peut vous être proposée. Si vous n’êtes pas éligible à cette procédure, votre inclusion dans un protocole de recherche, évaluant l’efficacité de nouveaux traitements sur l’évolution hématologique de votre maladie, peut être discutée.
La recherche clinique vise à améliorer la prise en charge thérapeutique des patients. L’institut de la Leucémie travaille avec le Centre d’Investigations Cliniques à l’hôpital Saint-Louis sur plusieurs essais thérapeutiques.