- L’institut
- Un nouvel Institut Hospitalo-Universitaire
- Programme médico-scientifique
- Histoire de l’hématologie sur le campus de Saint-Louis
- Gouvernance de l’Institut
- Espace presse
- Nous contacter
- Notre actualité
- Portrait de Valéria Bisio, chargée de recherche
- Création d’une unité d’hémato-oncogénétique
- Portrait d’Alice Gros, patiente pair-aidante
- Lauréats du premier appel à projet de l’Institut de la Leucémie
- Portrait de Julien Calvo, chercheur
- Nous soutenir
- Nous rejoindre
- Vous êtes
- Patients et proches
- Être soigné et accompagné
- Nos services cliniques
- Nos soins de support
- Traitements anti-cancéreux
- Notre recherche clinique sur les leucémies
- Devenir patient expert
- Découvrir l’Institut
- Chercheurs
- Recherche
- Essais cliniques
- Découvrir l’Institut
- Professionnels de la santé
- Adresser un patient
- Notre recherche clinique
- Découvrir l’Institut
- Un nouvel Institut pour la lutte contre la leucémie
- Histoire de l’hématologie sur le campus de Saint-Louis
- Industriels
- Découvrir l’Institut
- Recherche translationnelle
- Donateurs
- Nous soutenir
- Découvrir l’Institut
- Soin
- Prise en charge des patients
- Etre soigné à l’Institut de la Leucémie
- Traitements anti-cancéreux
- Soins de support
- Réunions de concertation pluridisciplinaires ouvertes
- Nos services cliniques
- Hôpital Saint-Louis – Service Hématologie Adultes
- Hôpital Saint-Louis – Service Hématologie Greffe
- Hôpital Saint-Louis – Service de Pharmacologie et Investigations Cliniques
- Hôpital Saint-Louis – Service Adolescents Jeunes Adultes
- Hôpital Saint-Louis – Unité ambulatoire d’hémato-oncogénétique
- Hôpital Saint-Louis – Service Hématologie Séniors
- Hôpital Robert-Debré – Service d’Hématologie et immunologie pédiatrique
- Hôpital Necker – Service d’Hématologie Adulte
- Hôpital Cochin-Port Royal – Service Hématologie Clinique
- Hôpital Avicenne – Service Hématologie Clinique et Thérapie Cellulaire
- Nos laboratoires de biologie médicale
- Laboratoire d’hématologie biologique, Michaela Fontenay
- Laboratoire d’hématologie biologique, Jean Soulier
- Unité fonctionnelle de génétique moléculaire, Hélène Cavé
- Laboratoire d’hématologie biologique, Vahid Asnafi
- Informations pour les patients
- Leucémies Aiguës Myéloïdes
- Leucémies Aiguës Lymphoïdes
- Néoplasies Myéloprolifératives
- Syndromes Myélodysplasiques
- Traitements anti-cancéreux
- Soins de support
- Accompagnement des patients atteints de leucémies
- Recherche
- Nos équipes de recherche
- Equipe de Hugues de Thé – Pathologie Moléculaire
- Equipe de Raphael Itzykson – Médecine de précision fonctionnelle des leucémies
- Equipe de Michaela Fontenay – Hématopoiese normale et pathologique
- Equipe de Françoise Pflumio – Niche, cancer et radiation dans l’hématopoïèse
- Equipe de Sylvie Méléard – Evolution de populations et système d’interactions de particules
- Equipe de David Michonneau – Immunologie translationelle en immunothérapie et hématologie
- Equipe de Lina Benajiba – Identification et ciblage des régulateurs extrinsèques des hémopathies myéloïdes
- Equipe de Karl Balabanian – Niches lymphoïdes, chimiokines et syndromes immuno-hématologiques
- Equipe d’Alexandre Puissant – Bases moléculaires du développement des leucémies aiguës myéloïdes
- Equipe de Stéphane Giraudier – Hémopathies myéloïdes chroniques, microenvironnement & recherche translationnelle
- Equipe de Diana Passaro – Leucémie et dynamiques de la niche
- Equipe de Camille Lobry – Contrôle génétique et épigénétique de l’hématopoïèse normale et maligne
- Equipe de Jean Soulier – Aplasie et leucémies secondaires
- Equipe de Sylvie Chevret – Biostatistiques et épidémiologie clinique
- Nos plateformes technologiques
- Notre recherche clinique sur les leucémies
- Participer à un essai clinique
- Portail de transparence
- eTHEMA : La cohorte des patients atteints de leucémies
- Enseignement
Accueil Prise en charge des patients atteints de leucémies et de maladies apparentées Leucémies Aiguës LymphoïdesLeucémies Aiguës Lymphoïdes
...Qu'est-ce qu'une leucémie ?

Définition
LeucémieVotre sang contient des cellules cancéreuses. Ce sont des cellules sanguines immatures appelées « blastes ».
AiguëLa maladie s’installe rapidement et le traitement doit commencer dans les jours suivant le diagnostic.
LymphoïdeUne anomalie survient dans la différenciation des cellules lymphoïdes dans la moelle osseuse.
LeucémieVotre sang contient des cellules cancéreuses. Ce sont des cellules sanguines immatures appelées « blastes ».
AiguëLa maladie s’installe rapidement et le traitement doit commencer dans les jours suivant le diagnostic.
LymphoïdeUne anomalie survient dans la différenciation des cellules lymphoïdes dans la moelle osseuse.
Types de leucémies aiguës lymphoïdes
85%Phénotype B
15%Phénotype T
Comprendre les leucémies aiguës lymphoïdes
Son origine est souvent inconnue et elle n’est pas contagieuse.
Les « lymphoblastes » s’accumulent dans votre moelle osseuse qui ne parvient plus à assurer
correctement la production de cellules sanguines normales.Exposition à des rayonnements ionisants
ou à certains produits chimiques
(benzènes), les chimiothérapies et
radiothérapies proposées pour traiter
d’autres cancers.Certaines maladies génétiques (Trisomie
21, Fanconi, Li Fraumeni…) et maladies
hématologiques préexistantes (syndrome
myéloprolifératifs).- Fatigue, pâleur, palpitations et essoufflement : signes d’une anémie (manque de globules rouges)
- Fièvre et infections (notamment pulmonaires) : signes de leucopénie ou neutropénie (manque de globules blancs)
- Saignements (surtout des muqueuses) et hématomes : signes de thrombopénie (manque de plaquettes)
Ces signes reflètent une insuffisance médullaire : insuffisance de production des globules rouges, globules blancs et plaquettes par la moelle.
Syndrome tumoral : certains organes gonflent à cause de l’accumulation des lymphoblastes (rate, ganglions, testicules…)
Eventuellement : douleurs osseuses ou articulaires et signes neurologiques.
C’est le cancer le plus fréquent chez l’enfant avec :
- un pic d’incidence entre 2 et 5 ans
- un pic après 50 ans.
15 personnes sur 1 million sont atteintes de LAL
Le diagnostic de la LAL repose sur :
Une prise de sang (NFS) mesurer les différentes cellules sanguines et
d’identifier d’éventuelles anomalies (déficit en globules rouges, en globules
blancs, en plaquettes).Un examen de la moelle osseuse (myélogramme) dont l’analyse permet
d’identifier les cellules anormales, leurs chromosomes et leurs gènes.Une analyse du liquide céphalo-rachidien (LCR) qui permet de rechercher
une possible atteinte neurologique.La recherche
La biologie des LAL-T et LAL-B. La compréhension des mécanismes moléculaires de la progression tumorale.
Pour un sous-groupe des LAL-B présentant un réarrangement génique, l’évaluation de la maladie résiduelle au travers du suivi de ce réarrangement est plus fiable que le suivi traditionnel. Cela améliore l’analyse des résultats des patients.
Emmanuelle Clappier et son équipe
Les mécanismes fondamentaux du développement des LAL-T : récepteurs,épigénétique, génomique…
Certaines LAL-T (dites altérées pour la voie de signalisation PI3K) présentent une forte dépendance au glucose et, en cas de manque de glucose, assimilent de la glutamine. L’utilisation d’inhibiteurs à ces assimilations offre un piste thérapeutique innovante et prometteuse.
Vahid Asnafi et Elizabeth Macintyre et leur équipe
Les interactions dynamiques entre les cellules leucémiques de LAL-T et leur microenvironnement, en particulier les composants vasculaires.
Un réseau vasculaire sur puce de micro fluidique et un système de bio-fabrication de moelle osseuse humaine et de cerveau humain au sein d’un modèle préclinique pour analyser la réponse du système vasculaire à des stimuli spécifiques induits par la leucémie.
Diana Passaro et son équipe
L’interaction des cellules leucémiques de LAL-T et LAL-B avec les différents composants de la moelle osseuse.
Identification d’une population de cellules leucémiques dormantes, résistantes à la chimiothérapie, ce qui offre de nouvelles pistes de pronostiques et thérapeutiques. Développement d’un modèle d’os humanisé, qui permettra d’analyser les interactions intercellulaires induisant de la chimiorésistance aux cellules leucémiques.
Françoise Pflumio et son équipe
Suivez nos actions en vous inscrivant à la lettre d'information de l’institut
- Découvrir l’Institut
- Recherche translationnelle
- Notre recherche clinique
- Essais cliniques
- Être soigné et accompagné
- Un nouvel Institut Hospitalo-Universitaire

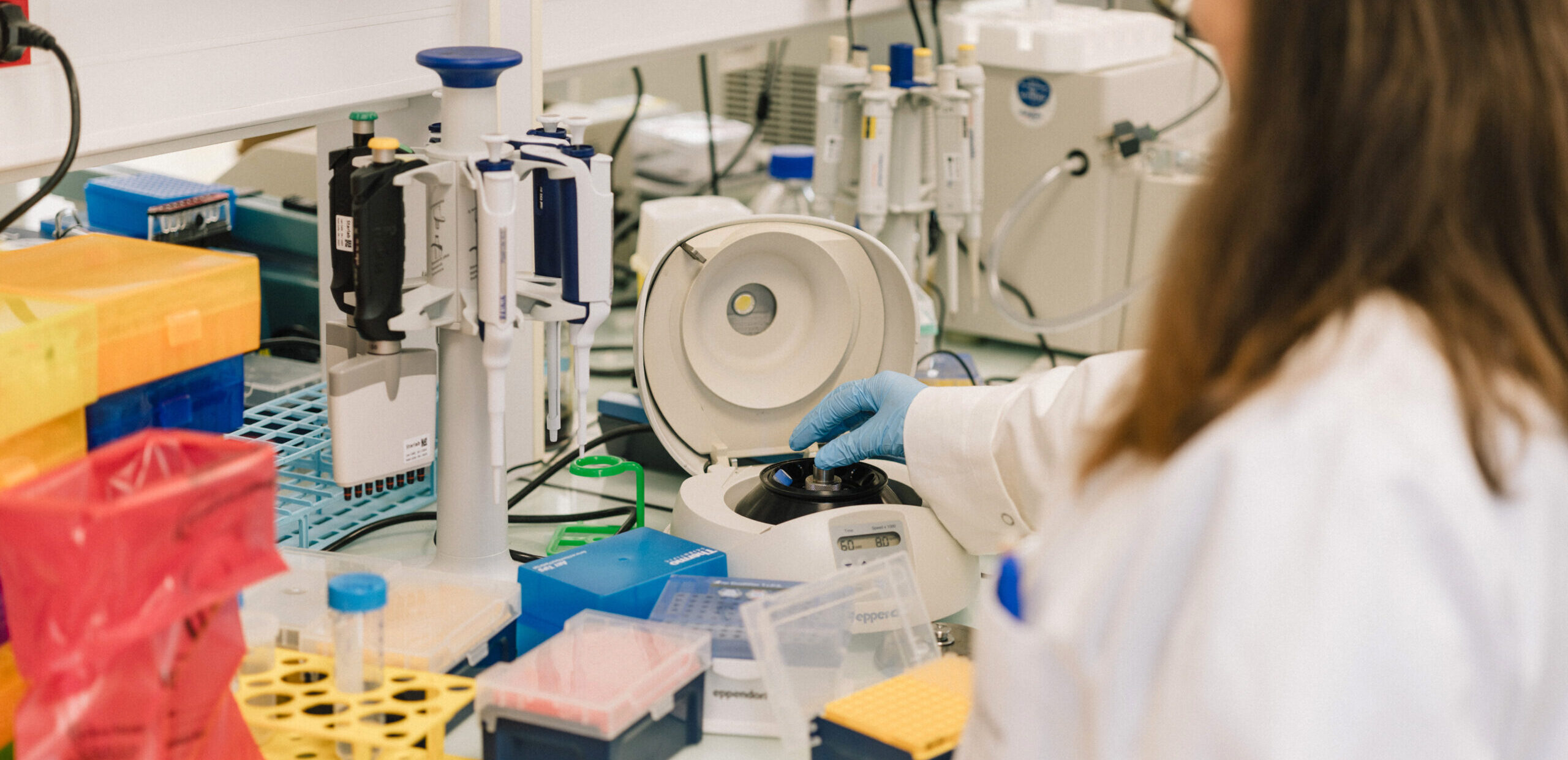



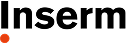
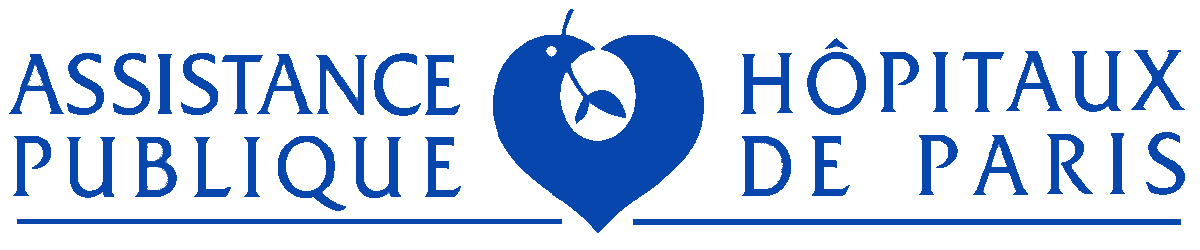


Traitements des leucémies aiguës lymphoïdes
Le traitement vise à obtenir la disparition des « blastes », permettant ainsi à la moelle osseuse normale de reconstituer les populations normales de cellules du sang (globules rouges, globules blancs, plaquettes).
Votre médecin peut vous proposer d’être inclus dans un essai clinique afin d’avoir accès à une molécule innovante et/ou de participer à l’amélioration des pratiques.
Il y a plusieurs phases de traitement.
1 semaine
Corticothérapie (prise de corticoïdes, des médicaments anti-inflammatoires)
Ponction lombaire avec analyse du LCR et injection de chimiothérapie.
Réalisation des examens nécessaires avant le début de la chimiothérapie (évaluation des différents organes par bilan biologique, échographie cardiaque, éventuel scanner, préservation de la fertilité, pose d’un cathéter central.
Pour connaître les caractéristiques de la maladie nécessaires pour débuter un traitement adéquat.
5 – 6 semaines d’hospitalisation (pour minimiser les risques d’infection)
Corticothérapie (prise de corticoïdes, des médicaments anti-inflammatoires) Polychimiothérapie en intraveineuse (plusieurs médicaments de chimiothérapie associés : vincristine, anthracyclines, cyclophosphamide, asparaginase)
Ponctions lombaires.
Pour éliminer les blastes présents dans la moelle osseuse et dans le sang.
Entraîne une période d’aplasie (= diminution des cellules sanguines)entraînant une baisse temporaire des défenses immunitaires. Possibilité d’antibiotiques ou de transfusions de plaquettes et de globules rouges .
Un myélogramme est réalisé à la fin pour vérifier si les blastes sont bien éliminés. Si c’est le cas, on parle de « rémission complète ».
Le traitement est adapté si vous avez plus de 65 ans (adaptation des doses de chimiothérapie), que vous êtes atteint d’une LAL B (association d’un traitement d’immunothérapie), ou que vous êtes porteur d’une anomalie génétique appelée chromosome de Philadelphie (ajout d’un traitement ciblé pour toutes les phases).
Quelques mois : hospitalisations de 3 -7 jours entrecoupées de retour à domicile.
Chimiothérapies de consolidation à forte dose et en alternance Immunothérapie (Blinatumomab) pour aider le système immunitaire du patient à détruire les cellules résiduelles de la maladie.
Ponctions lombaires.
Pour éliminer la maladie résiduelle et diminuer le risque de rechute.
Entre les consolidations, une phase d’intensification retardée s’intercale.
Corticothérapie (prise de corticoïdes, des médicaments anti-inflammatoires) Polychimiothérapie en intraveineuse (la même que dans la phase d’induction).
Généralement en ambulatoire mais nécessite souvent une ré-hospitalisation pour surveillance du risque infectieux en cas de baisse importante des globules blancs(aplasie).
Une radiothérapie encéphalique (utilisation de puissants faisceaux d’énergie pour détruire les cellules cancéreuses) clos la phase de traitement intensif.
Si vous présentez des risques importants de rechutes, une greffe de cellules souches est réalisée pour remplacer la moelle osseuse malade par une moelle saine provenant d’un donneur compatible (souvent une personne de la famille. Si vous êtes porteur du chromosome de Philadelphie, les consolidations consisteront en une alternance de chimiothérapies hautes doses et de Blinatumomab associé au traitement ciblé. La prise de ce dernier continuera durant la phase d’entretien qui comportera alors des ré-induction.
2 ans, en ambulatoire
2 chimiothérapies orales
Chimiothérapie intraveineuse mensuelle et à des corticoïdes → Seulement la première année
Dans certains cas, on pourra vous proposer de participer à un protocole de recherche clinique. Vous devrez signer un consentement écrit et conserverez la possibilité de vous retirer de l’essai à tout moment, sans avoir à fournir de justification.